UN PAS DE CÔTÉ - La fièvre de la mort : Hervé Micolet, "Les Cavales, I"
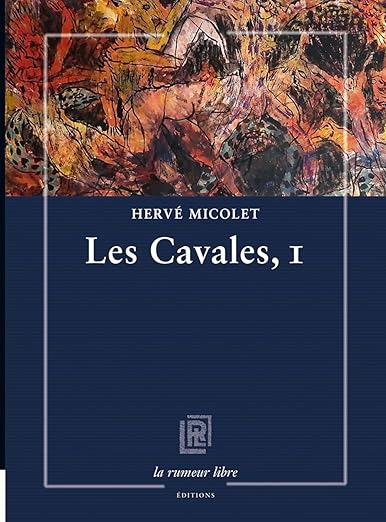
Hervé Micolet a tout du poète renaissant qui sort du silence pour porter le verbe haut. Sa poésie n'est pas prisonnière de vaines et viles divagations, des chemins empruntés au hasard pour peu qu'on fuie nos "tourments". Le travail précis et ciselé de la syntaxe, du lexique et des formes d'expressions traditionnelles témoigne du cheminement complexe et admirable d'une pensée loyale, sombre et mélancolique, parfois enflammée, assumée comme telle parce que féconde ; elle relève du "geste" quasi liturgique, quasi sacré qu'il ancre néanmoins – ne nous y trompons pas – dans la réalité terrestre de lieux qui lui sont familiers : le Forez, le pays lyonnais, la Loire et Saint-Étienne entre autres, mais aussi le Cher ("à la chapelle de Néronde").
Le titre du recueil, Les Cavales, traduit bien, me semble-t-il, ce cheminement authentique et courageux de la pensée du poète, sans cesse en mouvement, faisant route dans un monde désolé, peut-être fui longtemps par lui-même, avant que, bien décidé à l'affronter ou à en dire la beauté, il accueille la lumière qui chasse tout ce que contenait l'être de bile et de souffrance. Les Cavales témoignent en ce sens d'une tension voire d'une lutte permanente entre deux pôles de la pensée à la valence opposée et dont on ne sait qu'au terme de notre lecture celui qui, dans l'épreuve de l'écriture érudite et élaborée, l’emportera.
L'on entre dans le recueil au rappel de la fragile et éphémère beauté du monde et des faiblesses de l'Homme face au cours inflexible du temps. Le texte est ainsi comme effilé dans toute la longueur de l'Histoire ; il est empli de références antiques ("Vénus [...] en quoi certes tu es déesse / d'être cause de nous, toute puissante / sur nous tous"), de regrets romantiques ("car à peine il a resplendi l'Été / va moribond comme étant / du blé noir") et d’une mélancolie contemporaine mêlée d'une rancœur tenace et furieuse vis-à-vis de l'Homme qui, entre autres choses, n'entend pas les "sommation[s]" de la Nature ("Bien fait, / si notre espèce a mal fait avec toi"). Aussi les vers revêtent-ils par moments, un ton quasi prophétique et l'on devine peu à peu que la mort ("le sort d'agonie"), que le poète regarde courageusement en face, sera un des grands thèmes du recueil : "si bien que la Terre d'elle-même / se met dans son heur de mort et de ruine".
Là encore, c'est à la Nature que le poète s'adresse en rappelant cette vérité tragique : "les corps que tu fais sont battus, / finalement à mort, vaincus, / sans relèvement." La Terre-mère, ou la mère simplement ("la première, et la cause / qui peut faire naître ou non"), est évoquée dans des vers remarquables où la solennité du discours poétique faisant l'éloge d'un ordre juste des choses, "univoque à Dieu", est adoucie par le glissement vers un "toi" familier, signe de l'effacement du poète redevenu soudain un simple enfant : "Vous morte / comme il est incroyable, je vous crois / Vous, je ne crois que toi / en effet." L'on est ainsi touché par la force de caractère et de soumission d'un être "voué au chagrin", défendant la valeur du deuil par lequel s'exprime encore quelque vérité divine puisqu'il est dans ce monde (n'en déplaise aux "gens du deuil économe") de ces choses rares qui sont infinies.
Le constat est alors sans appel pour le poète "sourd à la consolation", dont la mélancolie funèbre devient de plus en plus envahissante à mesure que le temps passe, aggravée sans nul doute par la pratique de l'écriture (une "sottise") qui la retient, la soutient et la décortique. Cette mère morte au printemps "dans l'affreuse odeur des fleurs", il continuera de la voir vivante, élevée même miraculeusement comme la Vierge au jour de l'Assomption : "[Malade en hiver, / morte au printemps, ô terreur, elle est morte. Non, elle vivra.]" C'est que peut-être alors, malgré la mort ou la disparition, malgré la fatale destinée des hommes ("tout doit retourner, / Abîme avant tout"), malgré les rêves déçus de l'enfance, le monde, c'est-à-dire la Création ("l'œuvre") reste beau : "on doit admettre qu'il continue de l'être, / propice à la naissance, au grandir" ; cette mère morte "était belle" elle-même, comme l'était “la Première" femme dont les "yeux décillés [...] estonne à jamais l'Âme".
Le poète solitaire poursuit son évocation sensible et réflexive de la mort, dont il conçoit bien, malgré la beauté des choses, des êtres et du monde, malgré la foi en une présence divine, spectrale et discrète des êtres disparus, "perçant à peine la couche d'air", qu'elle "n'est pas rien pour nous". Là encore, le texte est bercé d'une voix mélancolique mêlée de regrets, allant parfois jusqu'au désespoir ("Par délicatesse / j'ai perdu ma vie.") et songeant à renoncer à tout : "de sorte que vous mes camarades / devez m'attacher aux mâts de la terre".
Heureusement, le poète n'a peut-être été pris que d'une forte fièvre qui lui fait tout voir, tout surprendre et tout souffrir. Arrivé au pic de son mal, il a comme guéri : "Quand je revins à moi / j'étais sauf, et le plus tranquillement." Vivra-t-il mieux pour autant ? Il s'affirme en tout cas comme individualité ("Et moi"), libéré un temps des souffrances ("mille corvées depuis l'enfance"), des croyances et des superstitions ("les morts ne sont plus rien") face à la mort "qui a raison de tout". Cependant, plutôt que de se placer "dans l'oubli des pensers de la mort" comme tous ceux qui "croi[ent alors] bien vivre", il couve déjà, pour une autre saison, peut-être le futur mois de Mai, sa prochaine fièvre. Il continue de se faire poète.
David Dielen
Hervé Micolet, Les Cavales, I, Éditions La rumeur libre, 2023, 235 pages.
Tous droits réservés ©