RECUEIL - L'ombre comme point d'ancrage du poète : Arthur Billerey, "La ruée vers l'ombre"
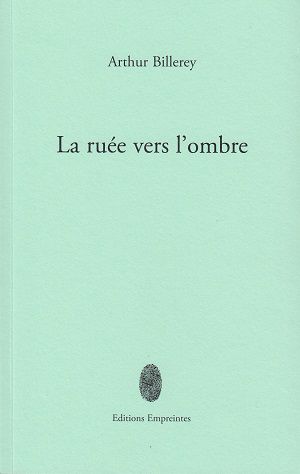
Membre de l'Académie Goncourt, Michel Tournier regrettait parfois, en découvrant les romans qu'on lui confiait, que les auteurs ne consentent pas à davantage d'effort quant au choix du titre. C'est un reproche que l'on n'adressera pas à Arthur Billerey tant celui qu'il a choisi pour son recueil, paru aux éditions Empreintes, est remarquablement bien trouvé.
Il y a dans le terme "ruée" (proche, par les sonorités et le mouvement d'ensemble qu'il décrit, de celui très poétique de "nuée") l'idée d'une urgence, d'une action vitale à accomplir, telle que le défi écologique, par exemple, nous l'imposerait, tout autant que celle d’une mise à l'abri, d’un refuge vers lequel on se précipite. Il revêt néanmoins une connotation particulière si l'on songe un instant à La Ruée vers l'or de Chaplin : la volonté discrètement affirmée du poète d'assumer une certaine légèreté malgré les ténèbres, voire de moquer ce mouvement empressé des hommes vers un endroit sombre, piégeux peut-être, un espace de sursis, d’illusion ou de perdition, semblables à ces prisonniers de la Caverne de Platon qui refusent de quitter le royaume des ombres. Ne dit-on pas, plus prosaïquement, que l'on se "rue" dans les magasins comme s'il s'agissait d'un mouvement irréfléchi, impulsif, un peu bête aussi ?
Aussi le titre du recueil décrirait-il une tentation vaine et préoccupante des hommes à un moment où il serait urgent qu'ils se tournent, qu'ils se "ruent" même, vers la lumière à même de les éclairer sur le fonctionnement du monde et, surtout, sur les nouvelles voies lui permettant de rester vivable. Peut-être l'auteur nous rétorquera-t-il que nous l'avons lu à l'envers, que l'ombre dont il est question ici n'a rien de métaphorique et qu'il est tentant, dans les périodes de fortes chaleurs et de dérèglement que nous avons connues - et que nous connaîtrons encore, d'inverser les codes et de nous réfugier justement aux endroits les plus frais, c'est-à-dire à l'ombre. En ce sens, le terme de "ruée" serait justifié par le sentiment d'insécurité et la panique qui s'empareraient des hommes face à la raréfaction de ces zones d'ombre, que l'on considérerait bientôt, au même titre que l'or, comme rares et précieuses.
L'entrée dans le recueil balaie rapidement toute tentative de cantonnement des textes dans une catégorie et toute lecture manichéenne. La sensibilité du poète et sa vision du monde sont contenues dans des vers à la fois percutants et enlevés, où priment le jeu sur les mots, le rythme et les sonorités, un savant mélange de drame et de légèreté et le souci presque permanent d'une chute réussie. Le poète incarne en ce sens une forme d’équilibrisme qui rétablit par les mots, qu'il a d'abord travaillés et assemblés, une juste proportion entre les choses opposées, une harmonie qu'il est bon de retrouver. Il est sur le fil, dans l'incertitude ("et advienne que pourra"), et dans un élan tendant à l'accomplissement, mêlant l'inquiétude et l'espoir ("je ne suis plus qu'à quelques brasses du soleil", ou bien, plus énergiquement, "hâtons la course à pied dans les grands fonds"). Tout cela est en réalité d'une bienveillance et d'une fraîcheur réconfortantes, comme l'ombre où il nous est offert de nous abriter. La poésie d'Arthur Billerey résiste en cela à toute forme d'aridité et de sécheresse. Elle se place judicieusement au croisement du jeu, de l'émotion et de la pensée.
Pour ce faire, elle est d'abord une écriture de la familiarité. L'utilisation répétée des pronoms de la deuxième personne du singulier ("tu", "te") nous rend chaque évocation plus proche, comme si les ombres vers lesquelles on se rue provoquaient un resserrement des liens, une union particulière, presque ontologique et fraternelle, en résonance très forte avec l'écopoétique. Telle est ainsi la révélation du poète, dans "il te ressemble" : "c'est bien connu / l'homme et la terre / se ressemblent et s'assemblent / jusqu'à la mort [...]". Il nous accueille alors à ses côtés, à une place privilégiée pour sentir, comprendre et admettre notre place dans une nature reconstituée ici dans un tableau merveilleusement suggestif (l'eau, les fleurs, les chevaux, les sapins, les mélèzes, les vieilles pierres, les oiseaux, les lézards, les plantes, les feuilles...), où les perspectives les plus alarmantes ("demain ce sera la surchauffe / les sapins ont viré au rouge") nous sont contées avec une douceur non moins cruelle. Il en ressort un ton prévertien très marqué dans l'ensemble du recueil (en particulier dans les magnifiques évocations du soleil) et remarquablement maîtrisé : "l'avenir sur ta main que j'aime / le vieux pourquoi sous le comment". On songe joyeusement à Yves Montand qui pourrait fredonner "les vieilles pierres" ou aux Frères Jacques reprenant en cœur : "il y en a qui durent". Pourquoi pas !
La poésie d'Arthur Billerey est originale en ce sens qu'elle est une écriture patiemment travaillée d'une oralité renouvelée, réinventée ou réappropriée, une transcription à l'écrit d'un langage simple et parlé qui fait entrer le lecteur dans ce que Céline appelait « le rail émotif », « la palpite ». La trivialité des mots en est l’une des dimensions. Elle assure au lecteur que le poète dit les choses comme elles sont, sans détour ni pincettes : "le soleil n'a plus rien à griller". De même, le recours fréquent à l'anaphore donne à certains vers l'allure d'un discours oral. Enfin, les ruptures et la segmentation du vers témoignent de l'irrégularité et de la plasticité de nos pensées et de nos questionnements au sujet des menaces qui planent au-dessus de nous, comme des ombres précisément : "cette ombre du réchauffement / puis-je seulement la comprendre / comprendre sans que je le veuille / autant que l'ombre sous les feuilles [...]". Plus loin, il s'interroge encore en filant la métaphore : "un jour il y aura autre chose / que l'ombre courante et connue / [...] Ce sera peut-être une nuit forte / sur un monde chauve et ferme".
Les inquiétudes sous-tendues par l'image de l'ombre sont celles qui concernent toujours le collectif, les malheurs du présent déclinés à la première personne du pluriel (songeons aux poèmes "pauvre de nous", "nos ombres endimanchées") et ceux, probables, de l'avenir des hommes et du monde ("un jour il y aura"). C'est là une autre dimension fondamentale du recueil, l'attachement au commun et à l'amour qui existe entre les êtres et qui est ce que l'on peut le plus regretter de voir disparaître : "ce serait triste de disparaitre / de te quitter sans te promettre / ce que nos mains jointes peuvent traire".
Certes, le poète adresse un réquisitoire sévère à tous les hommes dans le très beau texte "le triste exemple", qui synthétise peut-être le mieux toutes les dimensions de l'écriture d'Arthur Billerey. Il y cède, là plus qu’ailleurs, à la colère et à l'abattement : "pourquoi les plus belles couleurs sous l'eau doivent mourir".
Il reste néanmoins la force, la comédie des mots, le rire, "un réchauffement syllabique" cette fois, salutaire et prometteur, célébrant la vie, à laquelle le poète, refusant de céder au désenchantement, ne renonce pas.
David Dielen
Arthur Billerey, La ruée vers l'ombre, Éditions Empreintes, 2023, 89 pages.
Tous droits réservés ©