RECUEIL - Tendre l'oreille au vivant : Philippe Barrot, "Le Bruit des choses, I"
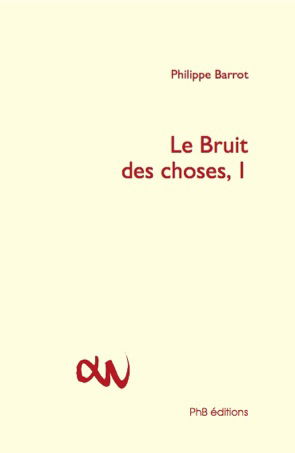
Il est très tentant de lire dans ces "choses" une référence au projet littéraire pongien, autrement dit à une tentative d’épuisement de leur représentation, menant à renouveler le rapport que l’être humain entretient avec elles, mais également avec lui-même. L’auteur du Parti pris des choses confiait ainsi : "Du fait seul de vouloir rendre compte du contenu entier de leurs notions, je me fais tirer, par les objets, hors du vieil humanisme, hors de l'homme actuel et en avant de lui. J'ajoute à l'homme les nouvelles qualités que je nomme." C'est là une entreprise vertigineuse et l'on comprend mieux, si Philippe Barrot s'en inspire bien, qu'il s’engage dans un projet au long cours, en indiquant d'emblée qu'il s'agit d'un premier tome.
La chose est quoi qu'il en soit un mot ambigu, ici comme chez Ponge. Aucun dictionnaire ne la décrit directement comme vivante ; pourtant, c’est bien le choix du vivant, animal et végétal, que fait l'auteur : "L'Éponge", "Le Caméléon", "La Méduse", "L'Algue brune", tels sont les titres qui défilent au fil des pages. Est-ce alors une tentative de disqualifier le sujet traité, en lui donnant le caractère d'une chose, c'est-à-dire d'un objet, d'une matière sans importance, sans personnalité, voire sans raison d'être, mais aussi d’en faire la chose du poète, c’est-à-dire sa possession, dépendante, soumise à lui, à ce qu'il veut en dire ou en faire ? Est-ce, au contraire, une entreprise de réhabilitation de la chose, considérée injustement de façon dépréciative, abandonnée aux seuls préjugés qui la définissent, tandis qu'il faudrait rigoureusement, c'est-à-dire indépendamment de l'esprit qui l'appréhende, l'explorer, la nommer, la traiter, y compris poétiquement ? Entendrions-nous ainsi Le Bruit des choses, ce qu'elles ont à nous dire, s'inscrivant comme nous, au même titre que nous, dans le monde ? On y verrait alors la marque de la dimension éco-poétique de l'ouvrage, qui inviterait le lecteur à l'écoute patiente, discrète et attentive des choses, voire au dialogue avec celles-ci, dans un registre poétique non dénué de légèreté et d'humour. L’on comprendrait dans cette perspective le choix judicieux de recourir à l’anthropomorphisme, incarnant les préjugés humains, qu’il s’agit de déconstruire pour mettre en lumière la nature véritable des choses traitées.
La première partie débute par l'annonce d'une catastrophe biblique : "Il plut quarante jours sur la cuvette parisienne." C'est l'occasion d'une mise à l'eau du poète, "en tenue de scaphandrier", lancé dans une exploration en profondeur qui le conduit jusqu'à l'éponge qui mène une vie pélagique. Sa première description ("Elle a une prolixité préverbale") place le lecteur dans un univers où l'inventivité du langage est au service d'une définition originale de l’animal, tordant le cou aux idées rebattues, à ce que l'on tire habituellement de ce mot comme images ou évocations péjoratives qui s'égrènent tout au long de cette première partie. Ainsi, plutôt que de l'associer à un excès de sensibilité, d’"affectivité", ou aux déviances alcooliques des humains ("elle boit à outrance"), le poète définit au contraire l'organisme marin sessile comme un être à l'anatomie fascinante, pas toujours matérialisable ("ses pores, une infinité de points de transmissions, exsudent au plus profond d'elle-même des secrets de langages non dits [...] Ce sont là filaments liquides, intuitifs, évanescents") ; il ajoute qu'il est doté d’une forme d’intelligence ("un peuple de ramifications", "neurones expansifs", "connaissances"), ouvert au monde, sensible, poreux, au sens propre comme figuré : "son système nerveux, le centre même de sa vie, s'est habitué à faire sienne la substance du monde." S’affirme alors la qualité nécessaire pour identifier ce qu’est vraiment le spongiaire : "une oreille accordée aux choses de la nature", aptitude qui porte le poète à la rêverie. Métamorphosée, placée sur terre, l'éponge devient autre chose, un drôle d’objet vivant, évoqué dans une description imagée riche et savoureuse. Elle est ainsi autant "une texture molle et duveteuse" qui "absorbe à qui mieux mieux", qu’"un coquillage crevassé" se faisant plus loin "érectile" et "karmique". C'est dans son double mouvement d'imbibition et d'assèchement, faisant songer au mécanisme vital de la respiration ou du muscle cardiaque, mais aussi d'assimilation, non plus de la substance, mais de toutes les substances du monde, y compris les plus dangereuses ("elle a bu des quantités marines, amassant des matériaux de construction, corpuscules organiques et miettes invisibles"), que l'objet se rapproche paradoxalement le plus de la nature, de ses cycles, des matières qui la composent et de ses vulnérabilités.
En est-il de même pour le caméléon ? Ses caractéristiques sont essaimées dans les pages qui lui sont consacrées et mêlées à des considérations là encore anthropomorphiques, dressant de lui un portrait original qui le place astucieusement au cœur du vivant. Ainsi, l'on redécouvre, entre émerveillement et amusement, le mimétisme et l'homochromie active propre à ce petit reptile d'Afrique et d'Asie, lui permettant de ne pas être repéré dans le lieu où il se trouve. Le poète souligne à ce propos, en jouant sur l'homophonie : "son lot sur terre une invisibilité, qui est son principe d'invincibilité." Dans le même temps, il montre l'ambivalence de ce qui est une qualité suprême dans le monde animal, mais un grave défaut chez l'être anthropomorphe dont il peint un portrait sans concession. Là encore, Philippe Barrot tente de déconstruire le référent imaginaire traditionnel associé au caméléon (un être versatile, "profiteur", "conformiste", "sans opinion", doué pour "la trahison" et ayant un goût immodéré pour l'hypocrisie) pour en réhabiliter implicitement la figure animale sensible et effacée : "une sensibilité cutanée abolissant la frontière des couleurs [...] avec le talent des passe-murailles, incarnant la discrétion au plus haut degré." Si l'on pouvait en dire autant de l'Homme !
La méduse est traitée de la même façon : l'auteur en présente d'abord la figure négative, échouée hors de l'eau, immobile et repoussante ("visqueuse", "engluée"), à proprement parler sans qualité ("inerte et amorphe", "molle") ; puis il se penche sur le caractère de l'animal "aquatique", vivant en symbiose avec son milieu naturel et dont la constitution complexe fascine, en ce sens qu'elle revêt une dimension oxymorique, naturellement poétique en quelque sorte : la "matière vivante" de la méduse est "une intimité corporelle sans neurones ni sang, une tache au milieu du vide, énigmatique intériorité qui se cache en se montrant."
En fin d'ouvrage, le je du poète, médiateur de la nature, est plus présent. L'évocation de l'algue brune est peut-être celle qui illustre le mieux, par les qualités que lui attribue en contrepoint l'auteur, les défauts sous-entendus de l'Homme, qui ont, sans aucun doute, conduit le monde à "la dégénérescence climatique" : sa "bêtise", son arrogance, son caractère belliqueux. L'algue brune elle est une "fine dentelle iodée", inoffensive ("elle-même ne s'attaque à personne") et discrète ; elle a "le sens inné du regroupement, du collectif", un modèle de communauté, en somme. La description presque autoptique de ses déplacements en fait un être raffiné, d'une grâce et d'une légèreté absolue : "elle flotte [...] grâce aux petites bulles d'air encapsulées dans les filaments de son corps ondulé, la mouvant à fleur d'eau".
Ainsi, le poète ne cherche pas tant, par une projection de l’esprit, à infiltrer la présence au monde de l’être naturel – exercice périlleux si ce n’est irrémédiablement voué à l’échec -, mais, sans renoncer à la rêverie poétique et à ses spécificités, il accepte de voir et d'apprécier le réel de la nature, avec curiosité, acuité et considération, pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire débarrassé des idées préconçues. Le recueil refermé, nous ne pouvons que nous languir d’un nouveau tome, dans lequel Philippe Barrot traiterait d'autres choses, dont le bruit et les tapages "à tout va et à qui mieux mieux" devraient continuer, entre légèreté et sentiment de gravité, de nous interpeller et de nous fasciner.
David Dielen
Philippe Barrot, Le Bruit des choses, I, PhB éditions, 2024, 48 pages.
Tous droits réservés ©